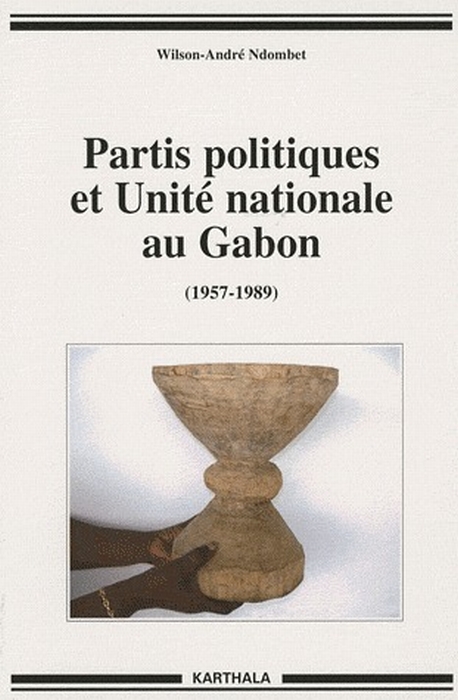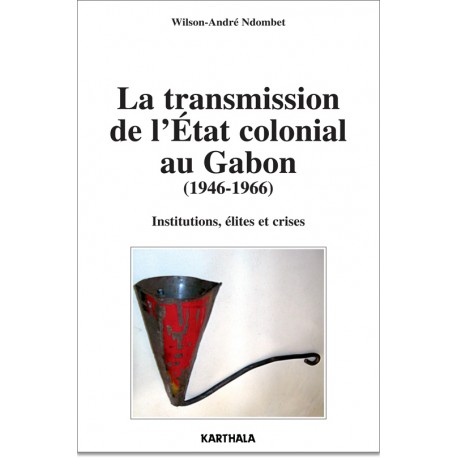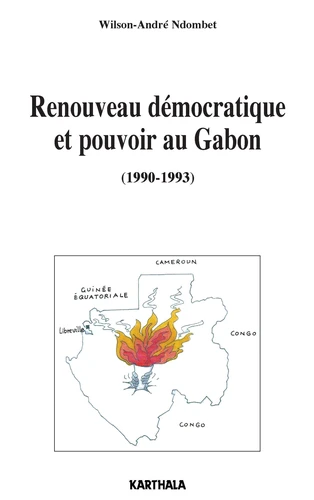Catalogue des œuvres
69 résultats
-
Le recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne : une sociologie du pouvoir au Gabon
Ce livre éclaire la question du recrutement des élites politiques et administratives à travers une analyse des liens sociaux. Il tente de comprendre pour l'Afrique subsaharienne et pour le cas Gabon en particulier la manière d'intégrer la vie politique et la haute administration. Il insiste sur la construction complexe qui combine le cercle social, le capital relationnel disponible et les liens sociaux.
- Auteur : Axel Éric Augé
- Date : 2005
-
Géopolitique de l'intégration en Afrique noire : travaux du Centre d'études et de recherches en géopolitique et prospective...
- Auteur : Marc-Louis Ropivia
- Date : 1994
-
Gabon, pourquoi j'accuse
- Auteur : Laurence Ndong
- Date : 2016
-
Mon projet pour le Gabon : comment redresser un pays ruiné par trois décennies de mauvaise gestion
Après avoir établi l'état des lieux : une société gabonaise en crise, minée par la peur, la faim, l'absence de réponse aux attentes des populations, le désespoir face à la maladie, aux aléas de la vie, l'apathie, l'indifférence, la corruption et vivant dans une relative " tranquillité civile " assurée par le despote, une pseudo-paix : " la paix des cimetières ", l'auteur critique les Accords de Paris de 1994 et la trop facile réconciliation de la classe politique autour du " gâteau ". Mais ce livre de Martin Edzodzomo-Ela est surtout la proposition d'un projet pour sortir le Gabon de plus de trente ans de pouvoir quasi absolu : comment redresser un pays miné par trois décennies de mauvaise gestion ? Le citoyen gabonais ou tout lecteur qui s'intéresse à l'avenir de ce pays d'Afrique centrale trouvera dans ce livre les idées fortes qui animent le candidat à la Présidence de la République gabonaise : une écoute prioritaire des aspirations du peuple, et en premier lieu des exclus, une démarche de liberté et d'indépendance vis-à-vis des puissances d'argent, un attachement profond à son pays. Il y découvrira surtout, dans les deux dernières parties de l'ouvrage, un programme pour mettre en valeur les richesses du Gabon, et une série de mesures pour réformer son système politique et économique. Le projet qu'il propose doit impulser une croissance viable afin de maîtriser la propension marquée à l'instabilité sociale et politique, parce que les changements de structures, dans tout pays en voie de développement comme le Gabon, suscitent et encouragent de nouvelles exigences : ce qui est communément perçu comme la " révolution des attentes nouvelles ". Aujourd'hui endormi et captif, le peuple gabonais est invité à se réveiller et à prendre son envol, comme le suggère la parabole de l'aigle qui clôt ce livre.
- Auteur : Martin Edzodzomo-Ela
- Date : 2000
-
Partis politiques et unité nationale au Gabon : 1957-1989
En 1960, après un demi-siècle de colonisation française, le Gabon devient un Etat indépendant. il est alors composé de pas moins d'une cinquantaine de communautés culturelles aux parcours historiques divers. Si l'Etat est constitué, la nation gabonaise, elle, n'existe pas encore. Dès lors, il revient à l'administration et plus encore aux partis politiques - le BDG, I'UDSG et le PUNGA - de s'engager dans la construction d'une véritable unité nationale. Mais des ambitions ethnicistes et de leadership politique entrent en jeu dès 1957, quand commence la transition institutionnelle avec l'Etat colonial. Elles se poursuivent à travers les élections chargées de donner naissance au nouvel Etat et jusqu'à la fin du règne de Léon Mba en 1967. Ces ambitions, qui radicalisent les postures de chacun des principaux leaders, finissent par entraver le processus même de l'unité nationale. A partir de 1968 et jusqu'en 1989, le régime de parti unique instauré par le président Omar Bongo, au lieu d'oeuvrer à la réalisation de cet idéal d'unité nationale, l'instrumentalise pour mieux concentrer et monopoliser le pouvoir. En 2009, au lendemain de l'élection à la présidence d'Ali, le fils d'Omar Bongo, il est important de revisiter le thème de l'unité nationale gabonaise, afin de mieux interroger sa signification.
- Auteur : Wilson-André Ndombet
- Date : 2009
-
La transmission de l'État colonial au Gabon : 1946-1966, institutions, élites et crises
Le discours du Général de Gaulle du 28 janvier 1944 représenta une ouverture majeure de la doctrine coloniale française et ouvrit aussi une nouvelle page de l'histoire des territoires colonisés d'Afrique noire. Il fut suivi d'un processus marqué par des lois définissant un nouveau statut pour les colonisés et par l'adoption de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette dernière prévoyait, dans le cadre d'une " Union Française ", l'octroi de la citoyenneté française, l'autorisation des partis politiques locaux et leur représentation dans les assemblées parlementaires métropolitaines. La loi Defferre de 1956, puis la Constitution de 1958, instituant une " Communauté franco-africaine ", réalisèrent une nouvelle étape, permettant la démocratisation des processus électoraux en Afrique, la constitution de véritables assemblées et conseils de gouvernement territoriaux. La transmission de l'État colonial était en marche sur le plan politique. Cette évolution s'effectua non sans contradictions au sein des " élites " et au fil de crises multiples. C'est dans ce contexte d'effervescence, qui dissimulait mal les antagonismes entre partisans de tous bords, que le Gabon devint indépendant en 1960. Ainsi émergea un personnel politique et administratif qui, obsédé par son positionnement aux sommets du pouvoir, s'écarta très vite des impérieuses nécessités de la construction d'un nouvel Etat. Mal-gré la présence d'une assistance technique française et d'anciens commis de l'administration coloniale, le Gabon ne parvint pas à combler ce hiatus originel. L'instrumentalisation de la Constitution par le président Léon Mba généra des actes impopulaires, sources d'un malaise persistant dans le pays. Cette dérive autoritaire déboucha sur le putsch du 18 février 1964 qui l'évinça du pouvoir. Il ne fut rétabli in extremis que par une intervention militaire française. C'est l'histoire mouvementée de cette transmission de l'Etat colonial aux Gabonais que W.-A. Ndombet nous décrit ici avec force détails à partir des sources d'archives.
- Auteur : Wilson-André Ndombet
- Date : 2009
-
Renouveau démocratique et pouvoir au Gabon : 1990-1993
A la fin des années 1980, après 21 ans de règne sans partage d'un parti unique, le Gabon entrait dans une période de crise, lourde d'incertitudes. En particulier dans les secteurs de l'administration publique ou privée, on assista à des manifestations multiformes qui avaient pour leitmotiv le renouveau démocratique. Le chef de l'Etat, Omar Bongo tenta d'y répondre en créant soudainement un nouveau parti politique, le Rassemblement social démocratique gabonais (RSDG), où les acteurs politiques de tous bords étaient conviés à préparer le retour au multipartisme intégral. Mais les forces sociales, jusqu'alors silencieuses, montèrent au créneau et rejetèrent sans ambages cette proposition. Après de nombreuses tractations, une Conférence nationale put se réunir de mars à avril 1990. Ses conclusions débouchèrent sur la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Les différents processus électoraux qui se déroulèrent de 1990 à 1993 confirmèrent apparemment cette ouverture politique. Mais la mise en place des nouvelles institutions se fit de manière très décevante, au point de faire redouter le retour à un parti unique. Cet ouvrage a pour objectif de restituer l'histoire de cette tentative d'ouverture démocratique, bientôt suivie par la réélection en 1993 du Président Bongo qui, ensuite, a su reprendre en main la gouvernance politique du pays. A un moment où ce pays semble en passe de connaître un nouveau tournant, le retour sur ce moment significatif peut être éclairant sur son avenir.
- Auteur : Wilson-André Ndombet
- Date : 2009
-
L'organisation administrative du Gabon de 1843 à nos jours
- Auteur : Max Remondo
- Date : 1970
-
Sur le chemin du développement de l'Afrique
L'Afrique a la possibilité de se développer, mais il existe chez les deux acteurs normalement déterminants dans cette entreprise complexe des handicaps qui l'empêchent d'y parvenir. Pour l'Africain, ce sont des traits de culture inhibiteurs. Pour l'Etat postcolonial c'est l'absence ou l'insuffisance des conditions fondamentales de développement.
- Auteur : Max Remondo
- Date : 2014
-
Gabon, la postcolonie en débat
- Auteur : Marc Mvé Bekale
- Date : 2003